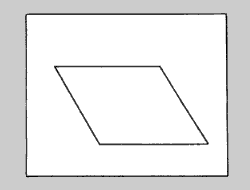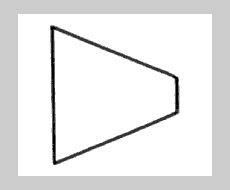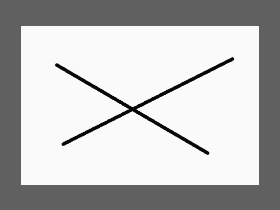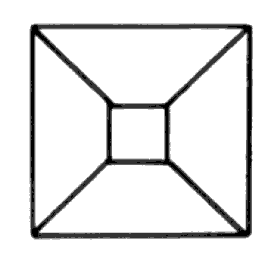|
PRÉAMBULE
Alors que toute perspective est illusion, à savoir la représentation de la troisième dimension sur une surface à deux dimensions, certaines perspectives vont encore plus loin, qui pourraient être assimilées à des figures ambiguës. Pour évoquer cette problématique, nous ne parlerons que de perspective fuyante à point de fuite central.
De par ses buts, la perspective fuyante nous demande de choisir, à la manière de toute perspective, entre deux images : celle de la platitude des tracés et celle de la pronfondeur illusoire. Il n'en reste pas moins que tout homo occidentalis modernus ignore le tracé matériel pour se complaire dans une profondeur qu'il sait illusoire. C'est ainsi que seuls les aveugles recouvrant la vue, quelques tribus amazoniennes et les plasticiens peuvent s'arrêter à la première interprétation : la matérialité graphique de l'image. Pire, vous pourriez encore ajouter que certaines peuplades n'ayant jamais été confrontées à des représentations photographiques ne sont pas à même de reconnaître leur visage sur une photo. Ainsi, plutôt que de cantonner l'image réaliste à la seule iillusion de la représentation spatiale, nous devrions considérer que toute image réaliste est déjà une figure ambiguë.
Mais, une autre critique, beaucoup plus intéressante, a depuis fort longtemps été portéé à l'encontre de la représentation de l'espace. Ainsi, parlant de certaines images, dans son Discours IV de la Dioptrique s'étonne-t-il : ...vû que, sur une superficie toute plate, elles nous représentent des cors diversement relevés et enfoncés et que, mesme suivant les règles de la perspective, souvent elles représentent mieux des cercles par des ovales que par d'autres cercles, et des quarrés par des losanges que par d'autres quarrés; ainsi de toutes les autres figures : en sorte que souvent, pour estre plus parfaites en qualités d'images, et représenter mieux un objet, elles doivent ne luy pas ressembler. (cité par , p. 67). En cela, chacun devrait devrait donc refuser que les bords d'une route semblent se rejoindre à l'horizon et que les arbres qui la bordent paraissent diminuer au fur et à mesure de leur échelonnement dans l'espace. Mais, en esclaves que nous sommes de notre système perceptif, nul ne se rebelle contre ces représentations visuelles aberrantes. Il est vrai que cette "manière de voir" donne des informations essentielles quant à l'éloignement des éléments qui nous entourent. Il n'en reste pas moins qu'un dessin d'enfant ou qu'une représentation archaïque sont mieux à même de rendre compte de la réalité matérielle du monde. Alors qu'un enfant représente les quatre pieds d'une table, la perspective fuyante lui en fait perdre un ou deux.
Cette critique de la représentation spatiale a été bien souvent oubliée, remplacée par celle du modernisme pictural qui affirme, par l'entremise de , qu'un tableau : n'est qu'une surface recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. Elle est pourtant cruciale en ce qu'elle se place avant toute pratique et toute matérialité, nous rappelant que nous ne représentons pas le réel mais la perception que nous en avons, et que notre système perceptif ne rend pas compte du réel tel qu'il est, mais de la représentation visuelle particulière que nous en avons. Nous pouvons aller encore plus loin dans la critique en affirmant que nous sommes dans l'ignorance même de la perspective (si à ce stade nous pouvons encore utiliser ce terme) que notre système perceptif utilise. Ainsi, beaucoup, de à , ont estimé que la perspective curviligne ou même sphérique étaient plus à même de donner à voir le monde tel que nous le percevons.


Mais si tant de raison et tant de raisons veulent que le projet de toute fiiguration réaliste soit paradoxalement de donner lieu à illusion, nous nous contenterons ici d'en rester aux moyens et aux procédés employés. Nous aurons à voir que toute perspective fuyante est en partie régie par un des principes plastiques permettant d'atteindre à l'équivoque de l'image : l'alignement ambigu. Nous aurons ensuite à rappeler que l'utilisation "dépravée" des lois de la perspective donne lieu aux anamorphoses considérées ici comme des images ambiguës relevant de la superposition équivoque (voir : Orientations,5 et Classification des orientations). Mais, avant que les anamorphoses ne soient connues, dès la Renaissance, architectes, sculpteurs et peintres utilsaient déjà deux autres dépravations : la perspective ralentie et la perspective accélérée. C'est ainsi qu'après avoir montré que la perspective classique est traversée par certains principes plastiques de l'ambigu, nous aurons encore, mais en d'autres pages, à parler de ces deux utilisations particulières et équivoques de la représentation spatiale.
LES PRINCIPES
Les perspectives linéaires sont à classer dans la catégotrie plastique de l'alignement équivoque en ce qu'elles ont à obéir aux lignes fuyantes. Les fuyantes représentent l'idée même de l'alignement plastique, en ce qu'elles disposent les formes et volumes sur des trajectoires que le cerveau de l'homo sapiens, vivant dans un monde d'images, respectera sans que les tracés en soient visibles et en l'absence même de toute connaissance préalable des lois et règles de la perspective.
Le père montre ainsi dans sa Perspective practique ces tracés que le regardeur utilise et applique, sans même avoir conscience de sa propre ignorance. Tant avec les formes architecturales (en haut) que végétales (en bas), les fuyantes régissent, en les alignant, les formes dessinées.

Mais cette belle organisation possède ses limites. En ce qui concerne l'allée bordée d'arbres, nous pourrions avoir des végétaux dont la croissance inégale rendrait la fuyante supérieure fausse et inutile. De même, un paysagiste, ayant abusé de l'alcool ou en avance sur son temps, aurait très bien ordonner ses plantations en zig-zag. C'est ainsi, que le révérend père , qui n'a pourtant pas abusé du vin de messe, se permet de faire déborder les deux derniers arbres des fuyantes qu'il a, lui-même, tracées, affichant ainsi son mépris pour l'alignement rigide du jardin à la française.
Mais l'architecture va nous sauver, qui ne permet pas ces désordres que la nature accepte. La gravure suivante présente un bâtiment en perspective oblique. En cette image, tout, de la cheminée jusqu'à la moindre brique, est régi par les fuyantes convergeant vers les deux points de fuite latéraux. En cela, cette perspective va plus loin que la précédente qui, comme toute bonne perspective frontale, laissait une certaine liberté aux plans perçus de face. Si il est vrai que les angles de ces plans s'ordonnaient déjà sur les fuyantes, il est pourtant possible d'organiser des rectangles qui, grâce à une utilisation judicieuse de la diminution de taille, en arriveraient à une profondeur illusoire sans utiliser la moindre fuyante. De plus, les fuyantes n'ont en ces deux gravures rien d'ambigu. Bien au contraire, elles régulent les tracés pour aboutir à un espace univoque. Qu'avons-nous donc là qui, au-delà ou en-deça de l'alignement, peut prêter à ambiguïté ? Des trapèzes !

Nous avions en d'autres pages (voir : La superposition ambiguë) déjà évoqué l'ambiguïté d'orientation du Parallélogramme. Le Trapèze, bien que moins célèbre est tout aussi ambigu. Cette affirmation, pour des raisons remontant à l'école primaire, en laissera plus d'un rêveur en ce qu'ils ne perçoivent pas la moindre once d'ambiguïté en ces deux formes géométriques. D'autres penseront que le Parallélogramme possède une forme plus ambiguë que celle du Trapèze. Pourtant, tous deux présentent au moins trois interprétations différentes et successives de leur tracé. Le premier peut être compris comme une surface frontale, un rectangle perçu en plongée qui s'éloigne de nous vers la gauche, un rectangle perçu en contre-plongée qui s'éloigne de nous vers la droite. Le second peut lui aussi être tout d'abord compris comme une surface frontale, puis comme un rectangle s'éloignant de nous vers la droite et enfin, vision beaucoup moins évidente, comme un trapèze dont le petit coté s'approcherait de nous.
Mais, quelque chose d'autre est encore commun à ces deux formes géométriques, quelque chose qui pourrait bien être à l'origine de l'ambiguIté de toute perspective. Car, si le Trapèze est la forme de base de la perspective fuyante oblique, celle du Parallélogramme est, quant à elle, constitutive de la perspective cavalière. Cet autre point commun est l'orientation oblique de certaines lignes de leurs contours respectifs. C'est ainsi que nous allons délaisser l'alignement pour aborder cet autre principe fondateur de l'ambiguïté de la perspective : l'orientation des lignes.
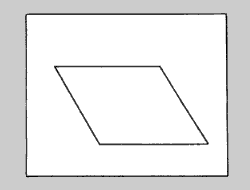  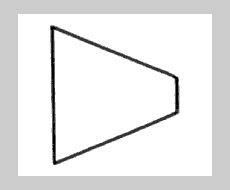
Toute perspective nécessite des obliques, puisqu'aucune ne peut se contenter des horizontales et des verticales. Ansi, tant les perspectives parallèles, qu'elles soient cavalière, dimétrique, isométrique, que les perspectives fuyantes, frontale, oblique et même d'une certaine manière curviligne, ont besoin des obliques pour donner l'illusion de la profondeur. L'ambiguïté particulière de ce type de ligne est connu depuis longtemps.
Il est ainsi quasiment impossible de dénombrer la quantité d'orientations possibles et réciproques des deux obliques de la Croix qu'a dessinée au 19ème siècle. Une fois la vue frontale perçue et éliminée, nous devrions appliquer une rotation mentale, degré par degré à partir de leur point central, à chacune de ces deux lignes pour obtenir les différente relations d'orientation que leur tracé à la surface du papier peut exprimer dans le réel. Bien évidemment nous n'évoquerons pas les innombrables échelonnements qui peuvent encore les réunir ou les séparer.
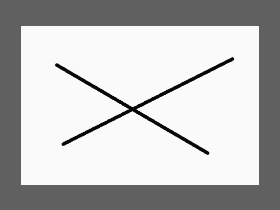
Mais, alors que l'échelonnement nécessite des organisations complexes, telles que la diminution de taille, l'étagement ou le recouvrement, pour mettre en place une représentation illusioire de la profondeur, l'orientation se contente des obliques pour donner lieu à sa propre illusion.
Nous voyons ainsi que l'oblique est l'élément graphique le plus à même de rendre compte de l'orientation dans l'espace. Il est un fait que ce type de direction de ligne est plus équivoque que la verticale ou l'horizontale, même si ces dernières n'échappent pas à l'ambiguïté. Mais ayant déjà parlé et tenté de classer l'équivoque de ces trois directions, nous ne reviendrons pas sur le sujet.
Pour cela, vous pouvez consulter les deux tableaux suivants afin d'en avoir un aperçu graphique :
Ambiguïtés des orientations de lignes au sol
Ambiguïtés des orientations de lignes volantes
Avec ce que nous venons de montrer, certains seront amenés à penser que seules les images dessinées donnent lieu à l'ambiguïté de la direction des oblques. Pourtant la perception du réel n'est pas épargnée par cettte équivoque. La photo ci-dessous présente des rayures donnant le sentiment que les fondations, non encore recouvertes, de ce bâtiment forment une escarpe. Ces rayures semblent s'incliner vers le mur afin de mieux en assurer la stabilité.

Pourtant, les mêmes lignes observées d'un point de vue différent montrent la réalité : ces obliques ne fuient pas, elles sont situées dans le plan vertical et frontal des fondations parfaitement rectilignes du bâtiment.
Pour une anlyse plus approfondie de l'image voir : L'escarpe.
Pour des horizontales qui se prennent pour des verticales voir : Le parking du Hâvre.

LES CONCLUSIONS
Nous allons avoir à revenir sur ce qui a été dit en introduction. Toute perspective, y compris la plus archaïque, peut-être rangée avec les illusions de profondeur en raison de la représentation illusoire de la troisième dimension sur une surface à deux dimensions. Mais, cette situation ne signifie pas pour autant que nous soyons là en présence de figures ambiguës, puisque tout un chacun verra le profond tout en ayant connaissance de la platitude du support. De plus, un autre constat est à ne pas oublier : des personnes, ignorantes des règles de la perspective et n'ayant jamais réalisé le moindre croquis perspectif, verront la profondeur et seront même capables de déceler certaines erreurs grossières de son dessin
La perspective tire sa force non pas tant de son texte (puisque la plupart des gens en ignorent les règles) que de son contexte. Ainsi, un premier contexte veut que les perspectives fuyantes essayent de rendre la perception que nous avons du réel. En cela, nous sommes tous habilités à avoir un avis et même un jugement sur les images qui cherchent à rendre la troisième dimension. Le deuxième contexte est interne à chaque perspective. Même si les règles en sont ignorées, elles donnent immanquablement lieu à un ensemble réglé et régulé, dont nous percevons, plus ou moins consciemment, la logique générale.
Ainsi, ce n'est pas tant la perspective en soi que nous avons à considérer comme figure ambiguë mais certains de ses éléments constiitutifs de base. Comme nous avons tenté de le montrer, l'ambiguïté de chaque perspective ne réside pas tant dans l'opposition du plat et du profond que dans l'équivoque d'orientation de certains de ses éléments constitutifs.
Ce croquis utilise les régles de la perspective centrale fuyante: le point de fuite central est situé au centre du carré, centre où viennent converger les quatre fuyantes. Pourtant, en l'absence de contexte, ce cube scénographique qui évoque un espace ouvert, est une figure ambiguë. Si beaucoup commencent par voir l'intérieur d'un cube, il est facile de renverser ensuite l'orientation des trapèzes et des obliques pour voir surgir vers nous une pyramide au sommet tronqué.
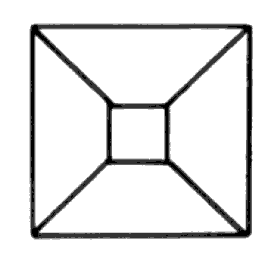
Cette image apparentée à un tracé perspectif, est donc une figure réversible. Comme toute figure réversible, elle obéit au principe plastique de la superposition équivoque. Ainsi, chaque trapèze contient en son tracé : une vue frontale (vue qu'il ne faudrait pas oublier en dépit du contexte), une vue fuyante et concave donnant lieu à un cube scénographique et une dernière vue fuyante et convexe qui transforme le cube en pyramide tronquée. Cette stratification des orientations n'est pas propre au trapèze, mais concerne la plupart des figures utilisant des obliques. L'orientation des obliques est l'élément crucial sur lequel repose toute perspective, et si une représentation perspective n'est qu'une simple illusion de profondeur, certains de ses éléments relèvent des figures ambiguës.
Vous pouvez consulter deux autres articles consacrés à la perspective. Le premier abordesur trois pages La perspective accélérée : Accélération de l'espace, Accélération de la peinture, Accélération du dessin.
Le second s'intéresse sur quatre pages à La perspective ralentie.
ICONOGRAPHIE
,
Entrée de l'empereur Charles IV à Saint-Denis,
Grandes Chroniques de France, enluminées par Jean Fouquet, Tours, vers 1455-1460
Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 6465, fol. 442 (Livre de Charles V).
WEBOGRAPHIE
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5710223n.planchecontact.f1.langFR
Les pages de la Perspective practique du père (1602-1670) sur Gallica.
BIBLIOGRAPHIE
Anamorphoses ou Thaumaturgus opticus, Flammarion, Paris, 1984. ISBN : 2-08-012604-0.
La perspective practique necessaire a tous peintres, graveurs, sculpteurs, architectes, orfevres, brodeurs, tapissiers, & autres se servans du dessein. Par un Parisien, religieux de la Compagnie de Jesus.
A Paris, chez Melchior Tavernier et chez François L'Anglois, dit Chartres. M.DC.XLII.
La perspective, collection Que sais-je ?, P.U.F.,Paris, 1963.
RETOUR AU SOMMAIRE
RETOUR À L'ACCUEIL
|
|